Comprendre la réforme du lycée en 2024 et choisir ses spécialités
Tout comprendre de la réforme du Bac et affiner son choix de spécialité dès la classe de seconde.
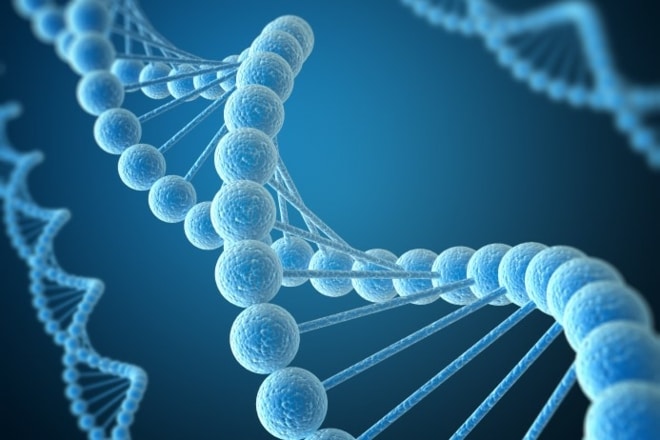



Les années lycées : trois années déterminantes
En Janvier 2018, Pierre Mathiot, directeur de l’IEP de Lille, mandaté par Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, rend son rapport “Un nouveau baccalauréat pour construire le Lycée des possibles”. Ce rapport constitue la première pierre de la reconstruction du baccalauréat à partir de 2021.
Le nouveau baccalauréat, en intégrant une part significative de contrôle continu en plus de l’épreuve terminale et en donnant un poids renforcé à l’oral, prend un nouveau visage. L’importance accrue du dossier scolaire et la présence d’enseignements de spécialité choisis dès la Seconde et à nouveau en classe de 1re font des années lycées des années déterminantes pour l’élève dans ses choix d’orientation futurs et sa réussite dans le supérieur. Le lycée n’est donc plus un “collège renforcé” mais bien une période propice à la construction de son chemin d’étudiant vers l’enseignement supérieur, et par la suite d’adulte.
Il s’agit finalement de transformer les trois années de lycée en années d’apprentissage mais également en années de réflexion sur son parcours et ses futures études supérieures. Si ces choix ne sanctionneront pas une orientation de manière définitive, ils restent quand même relativement discriminants.
La différence entre les attendus du collège et ceux du lycée se fait ainsi d’autant plus sentir et peut mettre en difficulté certains élèves. On peut, sans revendiquer l’exhaustivité, évoquer les dissemblances suivantes:
- Plus d’autonomie et plus d’oral : La réforme du Baccalauréat donne davantage d’autonomie au lycéen dans ses choix de cours et d’orientation en abordant une approche ou les élèves doivent savoir trouver la solution à un type de problème donné avec des clés d’analyse pour l’approche et la compréhension de ces problèmes , tout en accordant une importance nouvelle à un oral qui était jusqu’à présent le parent pauvre des études secondaires.
- L’importance accrue du dossier scolaire : Les bulletins scolaires sont pris en compte dans l’attribution de la note finale du bac, ceci afin de valoriser la régularité du travail de l’élève. En parallèle de la réforme du bac, certains concours post-bac intègrent désormais partiellement ou totalement dans leur sélection les notes obtenues au lycée, tant lors des contrôles continus que lors des épreuves anticipées de français.
- Plus de contrôle continu : Le contrôle continu, reposant sur des épreuves organisées dès la classe de Première, entre dans 40 % de la note finale.
- Les enseignements de disciplines de spécialité et leur impact sur l’orientation : Parcoursup (qui a remplacé APB) instaure le choix de spécialités dès la fin de la Seconde. Ces choix, figurant dans les dossiers scolaires, comptent -de facto- dans la sélection post-bac. Par conséquent, ils imposent aux étudiants d’anticiper la réflexion sur leur orientation en réfléchissant dès la seconde à leur projet personnel et professionnel.
En effet, bien qu’il soit obligatoire d’abandonner une spécialité à la fin de la 1re et possible de suivre une option en Terminale, les choix de spécialités de fin de seconde définissent d’ores et déjà les contours des futurs vœux d’orientation. A titre d’exemple, un étudiant ayant choisi -par appétence éphémère ou par contrainte- les spécialités « SVT », « Physique-Chimie » et « Mathématiques » pourra souffrir d’un manque de cohérence dans son parcours à l’heure de candidater à Sciences Po, si jamais son choix se porte finalement vers cette voie.
Ces évolutions donnent une importance nouvelle à un Baccalauréat auparavant décrié pour son unique valeur symbolique.
L’un des objectifs de la réforme du lycée, selon le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, est de faire du Baccalauréat un véritable tremplin vers la réussite dans l’enseignement supérieur et de permettre aux étudiants de développer un esprit critique. En effet, le fossé entre les exigences du lycée et les exigences du supérieur est important. Ce fossé n’a pas complètement disparu, voici quelques exemples de ces différences auxquelles les étudiants sont confrontés lors de leur entrée dans l’enseignement supérieur :
- Le sprint mental des concours et les partiels : Les évaluations dans l’enseignement supérieur sont très souvent concentrées sur une courte période (partiels universitaires, concours de classes préparatoires …). C’est un « sprint mental, psychologique et physique » auquel le lycéen n’est pas entraîné. Il l’est d’autant moins qu’une partie des épreuves du bac se fait désormais sous forme de contrôle continu.
- L’importance de l’oral pour les langues : L’enseignement des langues au lycée attache beaucoup d’importance à l’écrit tandis que dans l’enseignement supérieur c’est plutôt la réalisation d’une prestation orale qui est privilégié ; aussi bien lors de la sélection à l’entrée que dans le contenu pédagogique (cours enseignés en anglais à Sciences Po ou dans les écoles de commerce, oraux de langues en classes préparatoires…).
- La mobilisation des connaissances antérieures et leur cross-fertilization (fertilisation croisée) : La réussite dans le supérieur nécessite de comprendre le cours (et pas seulement de l’apprendre par cœur) mais aussi de savoir exploiter, utiliser les connaissances acquises sur des problématiques nouvelles, dans des contextes nouveaux. En effet, les examens prennent leur liberté par rapport aux exercices d’applications travaillés en classe pour tester, sinon la virtuosité, tout au moins la capacité du candidat à utiliser ses connaissances dans un cadre nouveau. C’est pourquoi, pour ne prendre qu’un exemple, un candidat qui a 16 de moyenne en Terminale (malgré les programmes du cycle terminal qui ne sont pas aisés) en faisant l’effort constant de comprendre son cours réussira toujours mieux ses concours post-bac (CPGE notamment) ou des examens qu’un étudiant avec la même moyenne mais se contentant de restituer le cours (ce que permettent encore les exigences du secondaire). Là encore, c’est un gap à franchir entre le lycée et le supérieur, et cela n’est pas toujours aisé.
Les années lycée : un concours continu ?
Finalement, les années lycée s’apparentent désormais à une sorte de « concours continu » puisque tout comptera, à la fois dans la sélection vers le supérieur (Parcoursup) mais également dans certains concours (Accès/Sésame, Sciences Po, écoles d’ingénieurs) : les choix de spécialités, les notes, les appréciations, les contrôles continus, les épreuves anticipées de français, etc.
Pour l’élève sortant du collège, cela demande d’acquérir de l’autonomie, de savoir organiser son travail personnel. Cela peut le mettre en difficulté et il est régulier de voir de (très) bons éléves de 3ème éprouver des difficultés à l’entrée au lycée.
Les différentes épreuves et matières du baccalauréat général
Depuis 2021, le baccalauréat a pris la forme de plusieurs épreuves pour le contrôle terminal, comptant pour 60% de la note finale :
- A la fin de la classe de première, les évaluations anticipées de la matière de français sont composées d’une épreuve écrite (coefficient 5) et d’une évaluation orale (coefficient 5).
- Pour les enseignements de spécialité que l’élève poursuit en terminale (donc sans celle abandonnée en 1re), deux épreuves sont prévues (au mois de juin désormais), chacune ayant un coefficient de 16.
- La matière de philosophie se voit attribuer un coefficient de 8 pour la voie générale et de 4 pour la voie technologique.
- Le Grand oral est évalué avec un coefficient de 10 dans la voie générale et de 14 dans la voie technologique.
Les 40% restants seront évalués en contrôle continu sur les années de première et de terminale :
- Les langues vivantes A et B, l’histoire-géographie, ainsi que l’enseignement scientifique pour la voie générale, et les mathématiques pour la voie technologique sont évaluées avec un coefficient de 6 chacune (3 en première, 3 en terminale).
- L’évaluation de l’éducation physique et sportive est basée sur trois évaluations en cours de formation (CCF) réalisées en classe de terminale, avec un coefficient de 6.
- L’enseignement moral et civique est évalué avec un coefficient de 2 (1 en première, 1 en terminale).
- L’enseignement de spécialité suivi exclusivement en première se voit attribuer un coefficient de 8, ce qui équivaut à la moitié des enseignements de spécialité choisis par l’élève en classe de terminale
Les bulletins scolaires de première et terminale générale : 10 % de l’évaluation
Il s’agit de la moyenne des notes obtenues aux DST dans les enseignements suivis en première et terminale. Toutes les notes ont un coefficient égal dans le calcul de la moyenne. Sont concernés :
- Les 8 enseignements communs : français, histoire-géographie, philosophie, LV1, LV2, enseignement scientifique, enseignement moral et civique, éducation physique et sportive.
- Des 3 enseignements de spécialité en Première puis les 2 conservés en terminale
- Des enseignements optionnels au choix : 1 suivi en classe de Première puis de terminale + 1 suivi en classe de terminale.
Pour les matières du latin et du grec, les points au-dessus de 10/20 sont considérées comme des points bonus (coefficient 3) et ajoutés à la somme des points obtenus par le candidat à l’examen.
Les épreuves communes continues : 30 % de l’évaluation
En classes de première et de terminale, 6 matières sont évaluées durant des contrôles continus, avec ici aussi un coefficient égal dans le calcul de la moyenne.
A noter que la copie est corrigée par un enseignant autre que le professeur du candidat dans la matière. Par ailleurs, les sujets sont composés d’exercices et d’énoncés centralisés dans une banque nationale numérique.
L’enseignement de spécialité suivi uniquement pendant la classe de Première est évalué en une seule épreuve en fin de Première.
Les épreuves finales : 60 % de la note finale du bac
Pour les épreuves restantes, les étudiants sont évalués sur un examen final, avec cette fois ci des coefficients différents selon les matières. Les spécialités et l’oral, qui est lié à celles-ci, représentent au total 42% (chaucune des spés de terminale étant coef 16, et le grand oral coef 10) des coefficients totaux. La philosophie vaut quant à elle 8 % de la note finale, soit un coef 8.
Le calcul des résultats, et l’affectation des mentions
Le baccalauréat, reste attribué, malgré la réforme, à partir de 10/20 de moyenne générale. A noter qu’il y a aucune note éliminatoire comme il peut exister dans certains concours. Le système des mentions est maintenu.
Enfin, le rattrapage continue d’exister pour les étudiants dont la moyenne initiale serait comprise entre 8 et 9,99 / 20. Les étudiants passent alors deux oraux parmi les 4 matières évaluées en contrôle final durant l’année de terminale. Si les notes obtenues aux oraux sont supérieures à celles des écrits, elles les remplacent et la moyenne est recalculée.
Cela donne donc :
- Moyenne générale < 8/20 : refusé sans rattrapage
- Moyenne entre 8 et 10/20 : 2 oraux de rattrapage
- Moyenne entre 10 et 12/20 : Admis sans mention
- Moyenne entre 12 et 14/20 : Admis avec mention Assez Bien
- Moyenne entre 14 et 16/20 : Admis avec mention Bien
- Moyenne supérieure à 16/20 : Admis avec mention Très Bien
A titre d’exemple, voici quel serait le calcul réalisé pour un élève fictif :
| Matières | Notes | Coefficient | Nombre de points total |
| Moyenne des contrôles sur table | 13 | 10 | 130 |
| Moyenne des 3 épreuves en contrôle continu | 11,5 | 30 | 345 |
| Ecrit de français | 12 | 5 | 60 |
| Oral de français | 13 | 5 | 65 |
| Philosophie | 7 | 8 | 56 |
| 1ère spécialité | 16 | 16 | 256 |
| 2ème spécialité | 13 | 16 | 208 |
| Grand Oral | 12 | 10 | |
| Option (ex : Mathématiques renforcées) | 12 | 5 (bonus : points au dessus de la moyenne) | 10 |
| TOTAL | 100 | 1250 |
Le total est donc de 1250 points sur 2000, soit une moyenne de 12,5/20.
L’étudiant aura donc la mention Assez Bien au baccalauréat !
Bac 2023 : Quelles sont les différentes spé qui existent au lycée ?
Il existe de nombreuses spécialités en voie générale au lycée. Si vous êtes en seconde et que vous devez faire votre choix de spécialités pour la classe de première, cette liste devrait vous aider. Attention, certaines spécialités sont plus “rares” et ne sont pas disponibles dans tous les établissements. Renseignez-vous donc bien au préalable pour éviter toute déconvenue.
Ainsi, voici ci-contre la liste des différentes spécialités existantes au lycée en voie générale (et non dans d’autres voies comme les lycées agricoles) :
- Art (objets d’étude : cinéma, audiovisuel, les composantes techniques du théâtre, danse, histoire des arts, arts plastiques, clés d’analyse pour l’approche et la compréhension des formes de création artistique, nouvelles attitudes des artistes, partenariat avec les structures culturelles locales pour des évènements et découvertes de nombreux spectacles permettant la critique sur la pluralité des pratiques, théâtre avec une expérience de spectateur approfondie, entre autres, etc.)
- Biologie-écologie (développement durable, problème en termes d’environnement, de santé, etc.)
- Éducation physique, pratiques et culture sportives (approfondissement ou exploration d’au moins cinq types d’exercices physiques différents, théorie dans les domaines de l’environnement sportif et artistiques, enjeux de santé liés au sport, etc.)
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques (objets études : rapports avec le pouvoir, enjeux géopolitiques passés et actuels, liens entre le monde et puissance internationale des états, enjeux de l’information, connaissances sur l’organisation politique de certains pays, etc.)
- Humanités, littérature et philosophie (questionnement sur l’Homme dès l’antiquité à l’âge moderne, grandes questions de culture philosophiques, période des Lumières, etc.)
- LLCER – Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (adaptation d’un texte, étude approfondie d’une langue étrangère ou d’une langue régionale (telle que le basque ou encore le breton), etc.)
- Littératures, langues et cultures de l’Antiquité (questionnement sur l’homme dans la cité à travers les objets d’étude suivants : “La cité entre réalités et utopies” ; “Justice des dieux, justice des hommes” ; “Amour, Amours)
- Mathématiques (algèbre, géométrie, calculs de probabilités, suites, limites des fonctions, etc.)
- NSI – Numérique et sciences informatiques (donner les clés d’analyse pour l’approche d’un algorithme dans un langage, pratique de l’écriture de codage, compréhension de différents logiciels et sites internets, nom de domaine, environnement informatique etc.)
- Physique-chimie (transformation de la matière, thèmes de la matière, des énergies, des ondes, du mouvement, etc.)
- SI – Sciences de l’ingénieur (mécanique, de l’électricité, des signaux, de l’informatique et du numérique liés aux sciences et à la technologie)
- SVT – Sciences de la vie et de la Terre (fonctionnement des systèmes vivants, enjeux contemporains de la planète, connaissance dans les domaines de la santé, l’environnement, etc.)
- Sciences économiques et sociales (appréhension des réalités sociales et économiques, notions de financement & monnaie, liens sociaux et sociabilité, etc.)
Bac 2023 : quels enseignements de spé pour quelles études/filières ? Comment choisir ses spés en seconde et première ?
La réforme du lycée et le choix des spécialités
Nous sommes conscients que le choix des spécialités, par son côté irréversible, revêt ainsi un enjeu particulier. Pour vous aider dans vos choix de spécialités, nous vous donnons ci-dessous quelques indications (qui sont aussi celles des responsables de ces filières) quant aux spécialités à privilégier en fonction de vos souhaits d’orientation.
Notez bien qu’il s’agit d’indications et non d’obligations ! A titre d’exemple, les dirigeants des écoles membres de la Conférence des Grandes Ecoles et ceux des classes préparatoires ont signé une charte mettant en avant une sélection sans « hiérarchie de spécialités ni parcours imposé ».
Nous détaillons d’abord les principales filières sélectives de l’enseignement supérieure et vous proposons en fin de page un tableau récapitulatif.
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Les CPGE scientifiques (PCSI, MPSI, PTSI, TSI, BCPST)
Ces filières demandent pour réussir un niveau scientifique important, et l’étudiant ne pourra pas faire l’impasse sur les spécialités associées. Pour les voies PCSI, MPSI, PTSI et TSI, les spécialités Mathématiques et Physique-Chimie sont quasi obligatoires. La troisième spécialité de terminale est plus libre et peut prendre en compte les goûts des étudiants. A noter que l’option Mathématiques expertes est là aussi vivement conseillée pour pouvoir tenir le rythme de la classe préparatoire.
La filière BCPST, légèrement différente, demande des connaissances en Sciences de la vie et de la Terre. Ainsi, cette spécialité devient vivement conseillée en première et en terminale. L’autre option conservée pourra être Mathématiques ou Physique-Chimie. A noter que selon le choix de cette deuxième spécialité conservée en terminale, il est conseillé de prendre option Mathématiques expertes (si combinaison SVT + Maths) ou Mathématiques complémentaires (si combinaison SVT + PC).
Les CPGE économiques (ECS, ECE)
Cette orientation demande tout d’abord aux étudiants d’avoir un profil complet, tout en montrant un niveau a minima correct en mathématiques. Cette dernière matière devient donc là-aussi vivement conseillée en première et en terminale.
Pour les choix restants, un choix relativement large revient à l’étudiant parmi des spécialités autour de l’histoire, de la géopolitique ou des langues. Si l’étudiant, au moment des choix de spécialités, souhaite déjà se tourner vers les classes préparatoires HEC, les spécialités Physique-Chimie et Sciences de la vie et de la Terre ne revêtent pas un intérêt particulier.
Enfin, l’option Mathématiques complémentaires est conseillée. Si l’étudiant fait le choix de ne pas retenir la spécialité Mathématiques en terminale, l’option Mathématiques complémentaires devient extrêmement conseillée.
Les CPGE littéraires (BL, AL, Chartes)
Ces filières nécessitent pour les étudiants y candidatant une culture littéraire, historique, philosophique, et de l’histoire des arts importante ainsi qu’un bon niveau de langues.
Ainsi, si aucune spécialité ne se distingue particulièrement, le choix peut se restreindre à Humanités, littérature et philosophie, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Littérature, langues et cultures de l’Antiquité ou Langues, littératures et cultures étrangères.
Les prépas B/L (prépa littéraire option Mathématiques) seront, exception faite, sensible à une spécialité Mathématiques ou à l’option Mathématiques complémentaires.
Quant aux options, le choix est là- aussi assez large et nous conseillons aux étudiants (sauf aux étudiants candidats en B/L sans une spécialité Mathématiques en terminale) les options Arts, Droit et grands enjeux du monde contemporain ou Langues et cultures de l’Antiquité
Pour les étudiants candidatant à la classe préparatoire à l’école des Chartes, les options Grec ou Latin sont cependant conseillées.
Les écoles d’ingénieurs Post-Bac
A l’instar des classes préparatoires scientifiques, ces filières demandent un bon niveau et un certain goût des mathématiques et physique-chimie.
Les concours Puissance-Alpha, Advance, Avenir et Geipi-Polytech proposent également dans leurs concours une épreuve d’anglais. La spécialité Langues, littératures et cultures étrangères peut donc être également un choix payant en option de Première, si les spécialités les plus logiques (Sciences de l’ingénieur, Numérique et science informatique, Sciences de la vie et de la Terre) n’enthousiasment pas l’étudiant.
En option, Mathématiques renforcées est là-aussi vivement conseillée.
Les écoles de commerce Post-Bac
Tout comme les classes préparatoires économiques, les étudiants présentant les concours des écoles de commerce Post-Bac (Accès, Sésame, Passerelle Bachelor, Pass…) doivent présenter un profil équilibré.
Les concours demandent d’abord un bon niveau de mathématiques et d’anglais, et de grandes connaissances des questions de culture générale. Ainsi, la spécialité mathématiques semble s’imposer. Pour accompagner cette dernière, l’étudiant dispose d’une liberté assez large, même si des spécialités telles que Sciences économiques et sociales, Numériques et sciences informatiques voire Langues et littératures étrangères peuvent se détacher.
Là aussi, l’option mathématiques renforcée est une bonne idée, notamment pour les étudiants qui souhaitent présenter le concours Accès, dont l’épreuve mathématiques est loin d’être évidente. Pour les étudiants visant plutôt le concours Sésame, l’option Maths complémentaire sera tout à fait envisageable également.
Les Instituts d’études politiques (IEP)
Les étudiants souhaitant intégrer un institut d’études politiques (IEP) doivent d’abord témoigner d’une curiosité pour le monde, la société et ses enjeux. Une fois dans ces institutions, les étudiants étudieront principalement l’histoire, le droit, la sociologie, les sciences politiques et l’économie, et les grandes questions de culture. Par ailleurs, les concours des IEP de Province (concours commun) propose dans leur concours une épreuve d’histoire et une épreuve d’anglais.
Ainsi, les spécialités Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Sciences économiques et sociales ou Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères sont les plus intéressantes pour les étudiants.
Quant aux options, le plus pertinent paraît droit et grands enjeux dans le monde contemporain (en terminale).
La PACES
La réforme de la PACES ne modifie pas singulièrement les pré-requis pour les étudiants.
Les spécialités les plus pertinentes sont sans surprise Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la vie et de la Terre. En terminale, il est indispensable de conserver la spécialité Physique-Chimie.
Dans une moindre mesure, la spécialité Humanités, littérature et philosophie peut également être une option envisageable.
Si jamais l’étudiant venait à ne pas suivre la spécialité Mathématiques en terminale, l’option Mathématiques complémentaire est fortement recommandée.
Tableau récapitulatif sur la réforme du lycée et le choix des spécialités en fonction de l’orientation envisagée :
Ces éléments synthétisent les déclarations des dirigeants d’écoles, responsables de filières, membres du ministère, mais aussi les informations recueillies par PGE PGO auprès de certains spécialistes (conseillers d’orientation, professeurs de classes préparatoires, directeurs d’écoles de commerce ou d’ingénieurs, jurys de concours en IEP…).
Il n’est pas à prendre « au pied de la lettre » mais permet d’insister sur les cohérences entre les spécialités et les choix d’orientation.
| Filières sélectives | Spécialités conseillées en première | Spécialités conseillées en terminale | Options conseillées en terminale |
| CPGE scientifique (PCSI, MPSI, PTSI, TSI) |
|
|
Mathématiques expertes |
| CPGE scientifique (BCPST) |
|
|
Mathématiques complémentaires (si choix de la Physique-Chimie en terminale) ou expertes (si choix des mathématiques) |
| CPGE économique |
+ 2 autres spécialités parmi :
|
|
|
| CPGE littéraire |
|
ou
ou
|
|
| Ecole d’ingénieurs post-bac |
|
|
Mathématiques expertes (en terminale) |
| Ecole de commerce post-bac |
+ 2 autres spécialités parmi :
|
2 parmi :
|
|
| IEP | 3 puis 2 spécialités parmi
|
Droit et grands enjeux du monde contemporain | |
| PACES |
|
|
|
Venez nous rencontrer
Nous savons que le choix de passer un concours/examen peut être source d’appréhensions de la part des étudiants et/ou de leurs parents.
C’est pourquoi nous organisons tout au long de l’année des événements gratuits destinés à apporter toutes les informations nécessaires sur les concours et sur nos préparations, avec des professeurs spécialistes, ainsi que toute une équipe à votre disposition.
Inscrivez-vous sans attendre à un de nos événements à venir !
Vous pouvez par ailleurs lire nos autres blogs juste ici.
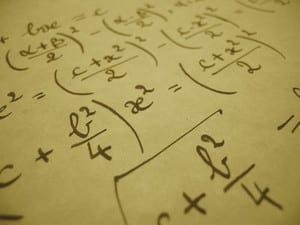
![[Objectif Sciences Po Paris /IEP après le bac] Comment se préparer dès maintenant ?](https://pge-pgo.fr/app/uploads/2024/04/vignettes-RI-web-26.png)
![[ORAUX AST] Objectif 20/20 : les conseils d’un juré diplômé d’emlyon](https://pge-pgo.fr/app/uploads/2024/04/vignettes-RI-web-25.png)
![[Post-bac] Intégrer une école de commerce en 2025 : comment se préparer efficacement dès maintenant ?](https://pge-pgo.fr/app/uploads/2024/04/vignettes-RI-web-29.png)
